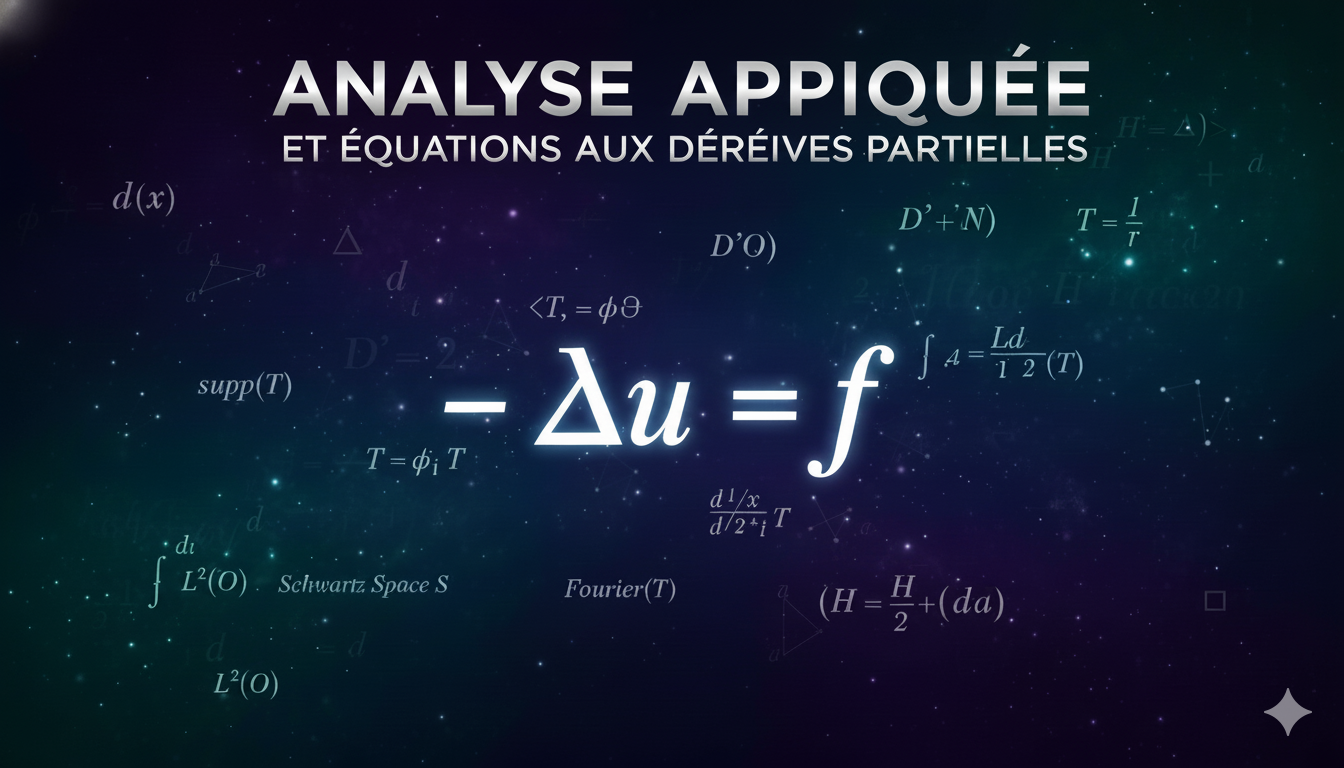
Introduction aux EDP en analyse fonctionnelle
Les équations aux dérivées partielles (EDP) décrivent la plupart des phénomènes physiques continus — chaleur, vibrations, écoulements, champs électrostatiques.
Mais longtemps, leur étude s’est heurtée à la question du sens des solutions : comment dériver, intégrer, ou même définir une solution quand elle n’est pas régulière ?
C’est précisément là qu’intervient l’analyse fonctionnelle.
Avant d’aborder les outils modernes, rappelons que les espaces
Lp(Ω) mesurent la taille moyenne d’une fonction, tandis que les espaces
Ck(Ω) ou
C∞(Ω) décrivent sa régularité. Ces deux approches, mesurable et lisse, vont se rejoindre dans les espaces de Sobolev.
Chapitre 1 — Les distributions
Au milieu du XXᵉ siècle, Laurent Schwartz révolutionne l’analyse avec la théorie des distributions.
Il donne un cadre rigoureux à l’intuition physique : on peut dériver des fonctions « mal » dérivables, comme la fonction de Heaviside ou le signe.
Dans ce cadre, une fonction devient une forme linéaire sur les fonctions tests
Cc∞.
On peut ainsi écrire et manipuler des EDP de manière cohérente, même quand les solutions classiques n’existent pas.
Cette idée ouvre la voie à une reformulation profonde des EDP : au lieu de chercher une solution point par point, on cherche une solution faible, c’est-à-dire une identité valable après intégration contre des fonctions tests.
Chapitre 2 — Espaces de Hilbert
L’analyse fonctionnelle, développée dès le début du XXᵉ siècle (Hilbert, Riesz, Fréchet), fournit un cadre géométrique : les espaces de Hilbert.
Ce sont des espaces de fonctions où l’on peut parler d’orthogonalité, de projection, de convergence — des notions essentielles pour les formulations variationnelles.
Les problèmes d’EDP deviennent alors des équations abstraites du type :
où
a est une forme bilinéaire continue et
H un espace de Hilbert.
Le théorème de Lax-Milgram (1954) garantit alors l’existence et l’unicité de la solution faible.
Chapitre 3 — Espaces de Sobolev et problèmes elliptiques
Les espaces de Sobolev, introduits par Sergueï Sobolev dans les années 1930, marquent une avancée majeure.
Ils permettent de combiner les notions d’intégrabilité (
Lp) et de dérivée faible (au sens des distributions).
Ainsi, on peut mesurer la régularité d’une fonction sans exiger qu’elle soit
C1.
Ces espaces sont devenus le langage naturel pour étudier les problèmes elliptiques (comme l’équation de Laplace ou de Poisson), qui modélisent les équilibres et les états stationnaires.
Les solutions y existent, sont uniques, et possèdent des propriétés de régularité remarquables.
Conclusion
De Schwartz à Sobolev, l’analyse fonctionnelle a transformé l’étude des EDP :
elle a permis de passer du calcul formel à une théorie abstraite mais rigoureuse, où l’on peut donner un sens et démontrer l’existence de solutions à des équations jusque-là inaccessibles.
- Enseignant: THIERRY CLOPEAU
